Nouvelle de gare…
La geste quotidienne, l’ensemble des actions de tous les hommes et de toutes les femmes entr’aperçues dans la journée, vient mourir au soir, comme une houle, sur l’écran blafard de l’écrivain. Il ne lui faut qu’un peu d’énergie, un talent moyen et beaucoup d’intérêt pour s’en saisir et répéter ces histoires que murmurent les jours.
L’histoire ci-dessous est toute simple. Si simple qu’elle ne mérite même pas son nom prétentieux de fable. Je l’ai cueillie toute chaude dans l’attente d’un train, dans cette salle des pas perdus où défilent et s’ignorent des milliers de destins. Elle date pour nous, car elle nous parle d’une guerre qui est terminée pour presque tout le monde – sauf pour ceux qui en ont été marqués dans la chair et l’esprit. Être témoin de cette anecdote fut pour moi un privilège, un cadeau très cher de la geste quotidienne. Avec toutes mes incapacités, je la partage.
*
Vendredi après-midi. La Gare Centrale est bondée de solitudes qui s’entrecroisent.
Le vieil homme flotte dans un manteau sans couleur et sans coupe. De sous sa casquette, ses yeux cherchent l’horloge blanche. Il la trouve enfin et l’observe plusieurs minutes, comme s’il voulait retenir le temps ou comme s’il était ébahi que les aiguilles aient navigué si vite.
Il se dirige vers un comptoir, achète un hamburger avec frites, puis s’installe à une table basse et circulaire, à un mètre du flot humain. Avec soin, il trie les frites fumantes et les dispose en rangs serrés, par ordre de grandeur, tout autour de l’assiette, tout autour du pain gonflé par la viande et les sauces.
J’ai faim. Et, de mon banc appuyé contre le muret qui encercle un des escaliers menant aux rails souterrains, j’ai envie de lui crier : « Mange, bonhomme ! Dépêche-toi ! Tes frites vont figer. » Il continue son interminable inspection.
Survient une jeune dame. Ma foi, bien tournée et couverte de bijoux or et topaze. Jolie brune. Trente ans au maximum. Elle s’arrête et regarde le manège. Aussi étonnée que moi ?
– Pourquoi tu fais toujours comme ça avec la nourriture ? demande-t-elle.
– Je fais comme je veux, rétorque-t-il avec un fort accent d’Europe centrale.
– Une vieille habitude ramenée des camps. T’as eu trop faim là-bas, dit-elle avec tendresse.
Et elle s’assoit.
– Mais ce n’est plus nécessaire maintenant. On a toute la nourriture qu’on souhaite.
– Parle pour toi, Natacha. Moi, je suis pauvre. Vous autres, vous êtes riches. C’est pour ça que je m’en vais. Je suis votre honte.
– Nous ne sommes pas riches, fait-elle, excédée. On mange à notre faim. Tu ne vas pas nous le reprocher ?
– Moi, je dis : vous êtes riches et vous n’avez plus de cœur ! Voilà ce que je dis.
De mon banc, il me semble voir des larmes dans les yeux de la jeune femme. Elle se lève et se dirige vers le comptoir. Maintenant que le siège est vide devant lui, le vieux se met à manger. De bon appétit.
Natacha revient, un café à la main.
– Ivan n’est pas avec toi ? demande le vieil homme.
– Edward, papa. Si tu appelais son fils par son vrai nom, déjà les choses iraient mieux avec Jim.
– C’est ton fils aussi, hein ? Il aurait donc dû s’appeler Ivan, comme mon père et comme moi. Ton mari n’aime pas les Juifs. Il ne m’aime pas. T’as vu comme il était furieux hier ? Il ne veut pas qu’Ivan m’écoute parler. Il ne veut pas que je parle avec mon propre petit-fils ! Il est dénaturé, et je le lui ai bien dit.
La femme retire son manteau et s’installe, résignée.
– Jim ne te déteste pas, mais il ne veut pas que tu effraies Edward, c’est tout. Tu n’es plus en Prusse Orientale et il n’y a plus de camps. Nous ne sommes plus en 1945, papa !
 – Il y a toujours des camps ! (Et il se frappe le cœur 🙂 Les camps sont toujours là ! Et il y en a encore, partout. Écoutes-tu les nouvelles, des fois ? Et il y en aura à l’avenir. Toujours, et de plus en plus. C’est pour ça que j’en parle à Ivan. Pour qu’il puisse reconnaître à l’avance ceux qui les construisent et les remplissent d’humains, comme nous.
– Il y a toujours des camps ! (Et il se frappe le cœur 🙂 Les camps sont toujours là ! Et il y en a encore, partout. Écoutes-tu les nouvelles, des fois ? Et il y en aura à l’avenir. Toujours, et de plus en plus. C’est pour ça que j’en parle à Ivan. Pour qu’il puisse reconnaître à l’avance ceux qui les construisent et les remplissent d’humains, comme nous.
Elle sourit avec tristesse, se penche et avance la main pour lui caresser la joue. Mais le vieil homme se recule, évite le contact.
– Ça lui donne des cauchemars, papa. Le psychologue de l’école en a parlé à Jim. C’est pas bon pour lui.
– La vérité est toujours bonne. Le psychologue, il est fou ! Les psychologues sont tous fous, c’est bien connu. C’est pour ça qu’ils choisissent ce métier-là, pour se rassurer.
Le vieillard dispose maintenant les restes avec soin dans un sac brun, près de sa valise cartonnée. La jeune femme regarde dans toutes les directions, elle cherche de l’aide peut-être. Les passants l’ignorent, ne la voient pas, fantôme parmi les fantômes. Quant à moi, j’évite aussi son regard ; je ne saurais que dire devant de tels désarrois, et j’en ai déjà suffisamment sur le dos. Du moins, c’est ce que je crois.
– À son âge, moi j’étais… commence-t-il.
– Dans les camps, je sais, interrompt-elle.
Elle fouille dans son sac et en sort un paquet de cigarettes.
– C’est mauvais pour les poumons.
– J’avais presque arrêté. C’est quand je suis tendue…
– Et moi, je te stresse. Tu vois, c’est beaucoup mieux que je retourne à Toronto.
Deux géants bardés de cuir s’approchent, entraînés par le flot. Ils sont chaussés de Doc Marten et portent des croix gammées et des croix de Malte à leur blouson. Le vieux a un mouvement de recul. La fille pose sa main sur la sienne. Cette fois, il ne refuse pas le contact.
– Calme-toi, chuchote-t-elle. Ils portent ces insignes comme ils porteraient la photo de leur rocker favori ou l’écusson de leur collège. Ça n’a pas de signification pour eux. Ils ne savent pas ce qu’ils font.
– Les jeunes S.S. avaient le même âge. C’est ce qu’on a dit après la guerre, à Nuremberg, qu’ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. Ça ne les a pas empêchés de tuer des millions de gens. Ceux de l’Est, les Rouges, ils portaient un marteau sur une faucille… Ils ne devaient pas savoir ce qu’ils faisaient, eux non plus. C’est pour ça qu’ils nous ont libérés des camps nazis pour nous fourrer dans d’autres. C’est dangereux des gens qui ne savent pas ce qu’ils font.
Natacha soupire et approche sa chaise. Elle se colle tout contre lui. Le vieux est devenu plus conciliant.
– Tu dois demeurer avec nous. C’est pas bon pour toi de vivre seul à Toronto. Tu ne fréquentes que d’anciens déportés, comme toi, et vous ne parlez que de ça.
– À Toronto, il y a moins de nazis.
– Il y en a tout autant. Tu le saurais si tu sortais de ton quartier et de ton cercle.
– Je te demande pardon ! Mordecaï a dit…
– Mordecaï est un malade ou un filou. C’est un sans-talent qui s’est fait un nom en tablant sur la peur de gens qui ont souffert mille morts, comme toi, ou sur la peur de leurs enfants.
Le vieil homme baisse la tête et soupire.
– Pourquoi le monde nous déteste-t-il ? Partout et toujours, comme ça ? Elle rougit et baisse la tête à son tour.
– Tu ne crois pas que Mordecaï ait raison ? continue-t-il. Il est né ici. Il sait de quoi il parle. L’as-tu déjà seulement rencontré ? L’as-tu déjà seulement écouté ?
– Oui. Une fois. Et je l’ai écouté.
– Tu ne crois pas qu’il ait raison ?
– Si les gens d’ici ont de la haine envers nous, je l’ignore. Ce que Mordecaï m’a surtout montré, ce qu’il m’a fait découvrir, c’est le mépris que je porte aux autres, c’est la peur que m’inspirent les gens d’ici… Ça, je l’ignorais jusqu’à ce que j’aille entendre Mordecaï, et je me suis détestée pour ça. Et je déteste Mordecaï de m’avoir révélé ces vilaines choses en moi. Tu me comprends ?
Le vieux la serre contre lui. Elle pose sa tête sur son épaule et il se met à chantonner. Sans doute une berceuse qui provient du fond des steppes et que des milliers d’enfants juifs ont entendue. Pendant quelques minutes, elle et lui sont seuls au monde. Les deux nazis bardés de cuir s’éloignent, et se perdent dans le flot des figures anonymes.
Soudain, elle relève la tête :
– Si seulement tu ne t’étais pas sauvé par la porte d’en arrière, comme un voleur, je serais venue te conduire. Ç’aurait été un départ moins triste, tu ne trouves pas ?
Il la regarde soudain avec le visage calme et réjoui de ceux qui viennent de trouver une solution acceptable à un problème difficile.
– Si seulement, toi, tu avais emmené le petit Ivan, peut-être que je me serais laissé convaincre de retourner vivre chez toi.
– Tu es sérieux ?
Et les yeux de Natacha brillent. De joie cette fois.
– Je n’ai pas d’autres filles que toi, tu sais. Ni de garçons. Quand je ne serai plus là et que tu ne seras plus là, il n’y aura qu’Ivan pour se souvenir de moi et de tous ceux de notre famille.
– C’est beaucoup de responsabilités pour les épaules d’un enfant. Tu ne trouves pas ?
– Mais si je ne lui en parle pas, qui va lui en parler ? Pas toi, certainement. Jim ? Encore moins ! Ici, en Amérique, les gens vivent comme s’ils étaient le commencement et la fin de toutes choses. Comme s’il n’y avait eu personne avant eux et qu’il n’allait y avoir personne après eux.
Natacha a posé ses coudes sur la table et a enfoui sa figure entre ses mains. Ce genre de discussions a dû se reproduire des dizaines et des dizaines de fois. Elle en connaît l’inutilité.
Une vieille femme pousse un chariot de supermarché où s’entassent vêtements et nourriture, ainsi qu’une couverte râpée, pour dormir n’importe où. Ivan lui sourit, se soulève de son siège et enlève sa casquette. La femme s’arrête un instant, montre des dents étonnamment blanches et saines pour son âge et agite la main en guise de salutations.
Natacha observe la scène, interloquée.
– Tu ne trouves pas qu’elle ressemble à Alietva ? La femme de ce pauvre Loubiakine, chez qui j’ai habité avant de me rendre au Canada ? Je t’ai souvent montré sa photo…
Elle soupire.
– Si c’est l’Alietva dont tu m’as souvent parlé, tu sais quel âge elle aurait aujourd’hui ?
– Non. Je n’ai jamais fait le calcul, bredouille-t-il comme un gamin pris en défaut.
– Cent douze ans ! avance Natacha triomphante.
– C’est peut-être sa sœur plus jeune ou une de ses filles alors ?…
– Tu ne démords jamais ! C’est de toi que les mules ont appris, lance la fille dans un rire.
De l’autre côté du vaste hall, deux policiers sortent un vagabond qui proteste. Il a dû demeurer plusieurs heures sur le même banc. Moi aussi et plusieurs autres occupons le même siège depuis plus d’une heure, mais nous portons cravate et souliers vernis, et nous avons un livre ou un magazine à la main. Aucun propriétaire de boutique ne songera même à porter plainte contre nous et nous n’aurons jamais besoin de vociférer notre indignation ; nous ne serons jamais accusés d’avoir troublé l’ordre public. Rassurant…
Le vieil homme désigne la scène à la jeune femme et hoche la tête. Il a l’air de dire : « Tu vois, les camps… »
Puis il la prend par les épaules et la regarde droit dans les yeux.
– Si tu revenais avec Ivan, le jeune Ivan, je crois bien que je retournerais chez toi. Faudrait que Jim me fasse des excuses, bien sûr…
– Tu es sérieux ! reprend Natacha, rieuse. Mais ton train ?… Il est dans dix minutes.
– Tu penses ! Mais non. Je me suis informé. Pas avant dix-sept heures quarante-cinq, au plus tôt.
– Ça serait pas plus simple de venir tout de suite ? Plutôt que de retourner chercher Ivan et revenir… Et repartir ?…
Le vieil homme se renfrogne.
– Question de dignité.
Elle passe son manteau et empoigne son sac, avant de l’embrasser et de partir précipitamment. Presque en fuite.
À peine a-t-elle franchi la porte tournante que les haut-parleurs grésillent l’appel : « Rapido, Montréal, Kingston, Toronto… »
Ivan se lève et se dirige vers l’escalier où le voyage l’attend. Avant de descendre, il regarde une dernière fois par-dessus son épaule.
*
Je me suis souvent demandé s’il savait qu’elle savait… Et si elle savait qu’il savait qu’elle savait… Si toute cette histoire de départ furtif n’était pas autre chose qu’un rite convenu, qu’une façon de rendre les séparations moins douloureuses. Il m’aurait fallu revenir, jour après jour, et attendre la répétition de cette scène pour savoir réellement… Des années peut-être. Et encore. On ne traque pas plus la vie que le vent.
Que les dieux s’arrangent avec ce fatras karmique et en sortent le souverain bien.
(Cette nouvelle a paru antérieurement aux Éditions Trait d’Union et Chat Qui Louche — éd. numérique.)
L’AUTEUR…
Auteur prolifique, Alain Gagnon a remporté à deux reprises le Prix fiction roman du Salon du Livre du Saguenay–Lac-Saint-Jeanpour Sud (Pleine Lune, 1996) et Thomas K (Pleine Lune, 1998). Quatre de ses ouvrages en prose sont ensuite parus chez Triptyque : Lélie ou la vie horizontale (2003), Jakob, fils de Jakob (2004),Le truc de l’oncle Henry (2006) et Les Dames de l’Estuaire (2013). Il a reçu à quatre reprises le Prix poésie du même salon pour Ces oiseaux de mémoire (Le Loup de Gouttière, 2003), L’espace de la musique (Triptyque, 2005), Les versets du pluriel (Triptyque, 2008) et Chants d’août (Triptyque, 2011). En octobre 2011, on lui décernera le Prix littéraire Intérêt général pour son essai, Propos pour Jacob (La Grenouille Bleue, 2010). Il a aussi publié quelques ouvrages du genre fantastique, dont Kassauan, Chronique d’Euxémie et Cornes (Éd. du CRAM), et Le bal des dieux (Marcel Broquet). On compte également plusieurs parutions chez Lanctôt Éditeur (Michel Brûlé), Pierre Tisseyre et JCL. De novembre 2008 à décembre 2009, il a joué le rôle d’éditeur associé à la Grenouille bleue. Il gère aujourd’hui un blogue qui est devenu un véritable magazine littéraire : Le Chat Qui Louche 1 et 2 (https://maykan.wordpress.com/).
du Saguenay–Lac-Saint-Jeanpour Sud (Pleine Lune, 1996) et Thomas K (Pleine Lune, 1998). Quatre de ses ouvrages en prose sont ensuite parus chez Triptyque : Lélie ou la vie horizontale (2003), Jakob, fils de Jakob (2004),Le truc de l’oncle Henry (2006) et Les Dames de l’Estuaire (2013). Il a reçu à quatre reprises le Prix poésie du même salon pour Ces oiseaux de mémoire (Le Loup de Gouttière, 2003), L’espace de la musique (Triptyque, 2005), Les versets du pluriel (Triptyque, 2008) et Chants d’août (Triptyque, 2011). En octobre 2011, on lui décernera le Prix littéraire Intérêt général pour son essai, Propos pour Jacob (La Grenouille Bleue, 2010). Il a aussi publié quelques ouvrages du genre fantastique, dont Kassauan, Chronique d’Euxémie et Cornes (Éd. du CRAM), et Le bal des dieux (Marcel Broquet). On compte également plusieurs parutions chez Lanctôt Éditeur (Michel Brûlé), Pierre Tisseyre et JCL. De novembre 2008 à décembre 2009, il a joué le rôle d’éditeur associé à la Grenouille bleue. Il gère aujourd’hui un blogue qui est devenu un véritable magazine littéraire : Le Chat Qui Louche 1 et 2 (https://maykan.wordpress.com/).
 A Propos pour Jacob
A Propos pour Jacob AA Le bal des dieux
AA Le bal des dieux B Le chien de Dieu
B Le chien de Dieu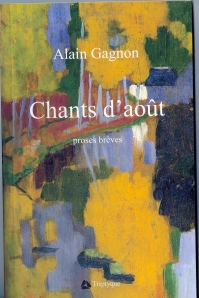 Chants d'août
Chants d'août Cornes
Cornes D Chroniques d'Euxémie
D Chroniques d'Euxémie E Kassauan
E Kassauan F Les versets du pluriel
F Les versets du pluriel FA Le truc de l'oncle Henry
FA Le truc de l'oncle Henry G Jakob fils de Jakob
G Jakob fils de Jakob H L'espace de la musique
H L'espace de la musique I Lélie ou La vie horizontale
I Lélie ou La vie horizontale J Le ruban de la Louve
J Le ruban de la Louve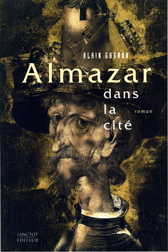 K Almazar dans la Cité
K Almazar dans la Cité L Thomas K.
L Thomas K. M Sud
M Sud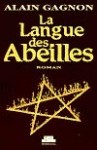 N La langue des Abeilles
N La langue des Abeilles O Gilgamesh
O Gilgamesh
Certaines horribles blessures ne guériront donc peut-être jamais… Elles laisseront sans doute sur les vivants des cicatrices externes plus ou moins apparentes, mais, plus profondément, derrière les murs de la chair, enfouis sous les décombres du passé, (si l’on s’y attarde un tant soit peu), on trouvera, avec consternation, encore quelques plaies ouvertes. Meurtrissures qui, pires que toutes les abominations, auront pu subsister. Une gangrène vicieuse qui aura lésé et stigmatisé une partie de l’humanité sur plusieurs générations.
Très beau texte Alain. Matière à roman.
-L.-
J’aimeJ’aime
Bonjour Luc,
Il y a eu un roman : Jakob, fils de Jakob, publié chez Triptyque.
Il nous faut prendre garde de ne pas créer les conditions favorables au développement d’autres gangrènes.
Bonne fin de journée,
Alain G.
J’aimeJ’aime