Les roches d’hiver…
Cette histoire débute avec l’arrivée du juge Lamarche à Roberval. Il venait à la rescousse du juge en place. On craignait que ce dernier, en raison de son âge avancé  et d’une récente maladie, ne succombât sous le poids des assises d’hiver qui s’annonçaient chargées. Le nouveau juge avait déjà fait un passage remarqué dans le vieil édifice du palais de justice construit le long du boulevard Saint-Joseph, la plus vieille artère de notre ville. Jeune avocat, il y avait gagné un procès retentissant. Pour la première, fois une grosse compagnie avait dû dédommager plusieurs petits propriétaires lésés. Sa nomination fut donc bien accueillie. Le magistrat et son épouse s’installèrent dans une coquette maison près du lac.
et d’une récente maladie, ne succombât sous le poids des assises d’hiver qui s’annonçaient chargées. Le nouveau juge avait déjà fait un passage remarqué dans le vieil édifice du palais de justice construit le long du boulevard Saint-Joseph, la plus vieille artère de notre ville. Jeune avocat, il y avait gagné un procès retentissant. Pour la première, fois une grosse compagnie avait dû dédommager plusieurs petits propriétaires lésés. Sa nomination fut donc bien accueillie. Le magistrat et son épouse s’installèrent dans une coquette maison près du lac.
La première cause que le nouveau magistrat entendit concernait un vagabond accusé d’avoir fracassé la vitrine d’un grand magasin. Selon le rapport de police, l’individu, un Montagnais, était bien connu et avait la réputation d’aimer la bouteille. C’était un modèle de douceur. Sa feuille de route faisait état de plusieurs vitrines volées en éclats. Toutes celles qui s’étaient effondrées sous l’un de ses cailloux auraient grandement suffi à ériger la devanture de trois magasins Gagnon et Frères.
L’accusé commettait son délit, s’assoyait sur le trottoir et attendait que les policiers le cueillent, tenant dans sa main la roche qu’il avait récupérée au risque de se blesser. Il ne touchait à rien. La scène se passait à la fin octobre ou au début novembre.
Impossible d’oublier ce visage. Pensez à un boxeur de la catégorie de ceux qui servent de sac aux jeunes débutants et qui offrent leur sang en spectacle. Ses arcades étaient bombées. Le nez occupait la moitié du visage. La mâchoire paraissait soudée au mauvais endroit, à la suite d’une vilaine fracture. Ses dents étaient grosses et croches. Ses vêtements étaient sales, bigarrés.
Quand le clochard remonta la longue mèche de cheveux noirs qui barrait son visage, le juge fut surpris par ses yeux. Ils étaient petits, très foncés et brillaient. Le regard respirait la bonté et la douceur. La vie ne l’avait pas choyé, se dit le juge.
Le tribunal débordait, ce matin-là, pour l’ouverture des assises. Le malheureux refusa un défenseur et plaida coupable d’une voix rauque, tellement éraillée que le juge eut de la peine à comprendre et dut consulter l’agent de sécurité. Pour le même délit, l’ancien juge l’avait condamné plusieurs fois à cinq mois de prison. Il se convainquit que cette peine était démesurée. Avec la magnanimité d’un débutant, il le gracia.
« Qu’on le libère ! » ordonna-t-il avec éclat.
Le vagabond se mit alors à vociférer dans la boîte des accusés. Le juge n’y comprenait rien. Le magistrat avait peine à déchiffrer ce que son nouveau protégé déclamait. Chose certaine, ça ne ressemblait pas à des formules de remerciement. L’homme de loi comprit lorsque le Montagnais traduisit en français ce qu’il avait crié dans sa langue. Ses mains difformes imploraient le ciel. Son spectacle se continua jusqu’à ce que le juge, excédé, le rappelle à l’ordre.
 De peine et de misère, le dos voûté et les jambes lourdes, l’accusé se rendit devant le bureau du magistrat et il demanda à l’agent de sécurité de s’éloigner. L’entretien dura quelques minutes. Ce fut l’accusé qui parla. On l’entendit jusque dans la salle. Il était question de roches et d’hiver… Lorsque soudain, l’accusé s’empara de la main du juge et la secoua.
De peine et de misère, le dos voûté et les jambes lourdes, l’accusé se rendit devant le bureau du magistrat et il demanda à l’agent de sécurité de s’éloigner. L’entretien dura quelques minutes. Ce fut l’accusé qui parla. On l’entendit jusque dans la salle. Il était question de roches et d’hiver… Lorsque soudain, l’accusé s’empara de la main du juge et la secoua.
Le Montagnais regagna la boîte des accusés. Le silence revint. Le juge reprit la parole, invoqua des éléments nouveaux au dossier, avant de condamner l’accusé à cinq mois de prison. L’homme applaudit.
Leur deuxième rencontre eut lieu l’été suivant.
Le juge dînait à la Tabagie Harvey, à proximité du Palais de justice. La nourriture y était bonne et c’était le seul endroit où l’on pouvait trouver un bon éventail de journaux et de revues. Le magistrat aimait lire en mangeant, et une loge, en retrait, lui garantissait un peu d’intimité. Le vagabond appréciait aussi l’endroit parce que le patron, surtout en période de dèche, savait se montrer généreux.
Le juge reconnut le clochard.
Son allure était la même. L’homme avait un sac usé jusqu’à la corde, qu’il tenait en bandoulière. Quand le proprio vint demander au visiteur de laisser le juge en paix, ce dernier s’y opposa.
« Monsieur est mon invité », dit-il en clignant de l’œil.
Ce midi-là, l’homme de loi apprit ce que le vagabond voulait dire quand il parlait de « roches d’hiver ». Cette expression l’avait intrigué lors de leur première rencontre. En regardant autour de lui, comme s’il avait peur, le clochard fouilla dans son sac, en retira plusieurs pierres de la grosseur d’un œuf. Elles étaient enroulées dans des chiffons et brillaient après avoir été polies. Ses doigts difformes les effleuraient en les rangeant sur la table.
Il en compta seize et les plaça dans un certain ordre.
Tous ses mouvements étaient religieusement étudiés comme si cela faisait partie d’un rituel. Le juge suivait la scène avec beaucoup d’attention. Qu’est-ce qui se cachait derrière ce visage, ce corps brisé ? Ses yeux ne mentaient pas. Tout son univers était enfoui dans ce sac qui contenait aussi un vieux croûton de pain, des bouts de ficelle, un moignon de crayon et un restant de vin dans une bouteille sale.
Le clochard raconta l’histoire de chacune des pierres. La première provenait de son lieu de naissance. La seconde, du bord du lac où sa mère l’avait lavé. La troisième venait du petit cimetière où reposait son arrière-grand-père qui lui avait appris à trapper. Une autre lui rappelait son terrain de chasse. Avec celle-là, il avait distrait un orignal traqué par des chasseurs. La dernière provenait du grand territoire de ses ancêtres où le gouvernement projetait de construire des portes d’eau. L’hiver, elles conservaient la chaleur. L’Amérindien parla longuement du pouvoir des pierres :
« Mes roches racontent ma vie, dit le vagabond de sa voix caverneuse. C’est ma mémoire, c’est tout ce que j’ai. C’est ma liberté, c’est aussi mon passeport-chaleur, comme diraient les Blancs. »
Le juge fut surpris par la qualité de sa langue. Ses mots étaient beaux, exacts, doux, chauds.
Il le laissa parler, ne mangea guère. Le clochard se contenta de porter à sa bouche le goulot de sa vieille bouteille.
L’automne revint. Le vagabond se retrouva devant le juge pour le même délit. Il passa l’hiver au chaud. Durant ce séjour, le pauvre hère accepta de se soumettre à  des tests d’aptitudes intellectuelles. Les résultats indiquèrent une intelligence supérieure à la moyenne et une vie intérieure intense. Ils démontrèrent des talents artistiques hors du commun. Il recouvra sa liberté et reprit sa vie de clochard.
des tests d’aptitudes intellectuelles. Les résultats indiquèrent une intelligence supérieure à la moyenne et une vie intérieure intense. Ils démontrèrent des talents artistiques hors du commun. Il recouvra sa liberté et reprit sa vie de clochard.
L’homme couchait sous les galeries, vidait des litres de mauvais vin et ramassait des bouteilles afin de pouvoir acheter de l’alcool. Dans les bars, on abusait de lui. Pour une bière ou un verre de vin, il improvisait toutes les pitreries possibles.
Une mauvaise grippe l’attaqua au début de l’automne. À la mi-octobre, des enfants le retrouvèrent mort, dans une crevasse remplie d’eau, le long de la voie ferrée. Ses mains étaient enfouies dans son sac. Les policiers amérindiens y trouvèrent une lettre adressée au juge Lamarche. On ne connut jamais son contenu.
Depuis vingt ans, le vieil homme de loi dépose un caillou de la grosseur d’un œuf sur le tombeau de son grand ami. La cérémonie se déroule à la mi-octobre.
Notice biographique
Notice :
 Jacques Girard est écrivain, journaliste, enseignant… Il est de plus un efficace animateur culturel : on ne saurait évaluer le nombre de fidèles qu’il a intronisés à la littérature québécoise et universelle. Ses écrits reflètent un humanisme lucide. De la misère, il en décrit. Aucun misérabilisme, toutefois. Il porte un profond respect à ces personnages bafoués par la vie qui hantent les tavernes, les restos et les bars semi-clandestins de sa ville. Il les connaît bien, et il ne se distancie pas d’eux. Il a conscience d’appartenir à la même espèce, pour paraphraser Lawrence Durrell. Nous considérons Des nouvelles du Lac son chef d’œuvre. Mais il nous a aussi donné, entre autres, Fragments de vie, Les Portiers de la nuit et Des hot-dogs aux fruits de mer.
Jacques Girard est écrivain, journaliste, enseignant… Il est de plus un efficace animateur culturel : on ne saurait évaluer le nombre de fidèles qu’il a intronisés à la littérature québécoise et universelle. Ses écrits reflètent un humanisme lucide. De la misère, il en décrit. Aucun misérabilisme, toutefois. Il porte un profond respect à ces personnages bafoués par la vie qui hantent les tavernes, les restos et les bars semi-clandestins de sa ville. Il les connaît bien, et il ne se distancie pas d’eux. Il a conscience d’appartenir à la même espèce, pour paraphraser Lawrence Durrell. Nous considérons Des nouvelles du Lac son chef d’œuvre. Mais il nous a aussi donné, entre autres, Fragments de vie, Les Portiers de la nuit et Des hot-dogs aux fruits de mer.
48.397865
-71.093784

 Saguenay–Lac-Saint-Jean pour Sud (Pleine Lune, 1996) et Thomas K (Pleine Lune, 1998). Quatre de ses ouvrages en prose ont ensuite paru chez Triptyque : Lélie ou la vie horizontale (2003), Jakob, fils de Jakob (2004), Le truc de l’oncle Henry (2006) et Les Dames de l’Estuaire (2013). Il a reçu à quatre reprises le Prix poésie du même salon pour Ces oiseaux de mémoire (Le Loup de Gouttière, 2003), L’espace de la musique (Triptyque, 2005), Les versets du pluriel (Triptyque, 2008) et Chants d’août (Triptyque, 2011). En octobre 2011, on lui décernera le Prix littéraire Intérêt général pour son essai, Propos pour Jacob (La Grenouille Bleue, 2010).
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour Sud (Pleine Lune, 1996) et Thomas K (Pleine Lune, 1998). Quatre de ses ouvrages en prose ont ensuite paru chez Triptyque : Lélie ou la vie horizontale (2003), Jakob, fils de Jakob (2004), Le truc de l’oncle Henry (2006) et Les Dames de l’Estuaire (2013). Il a reçu à quatre reprises le Prix poésie du même salon pour Ces oiseaux de mémoire (Le Loup de Gouttière, 2003), L’espace de la musique (Triptyque, 2005), Les versets du pluriel (Triptyque, 2008) et Chants d’août (Triptyque, 2011). En octobre 2011, on lui décernera le Prix littéraire Intérêt général pour son essai, Propos pour Jacob (La Grenouille Bleue, 2010).


 Publié par Alain Gagnon
Publié par Alain Gagnon 



















 A Propos pour Jacob
A Propos pour Jacob AA Le bal des dieux
AA Le bal des dieux B Le chien de Dieu
B Le chien de Dieu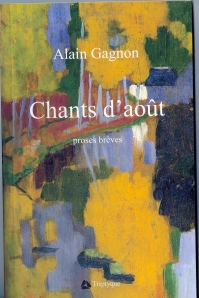 Chants d'août
Chants d'août Cornes
Cornes D Chroniques d'Euxémie
D Chroniques d'Euxémie E Kassauan
E Kassauan F Les versets du pluriel
F Les versets du pluriel FA Le truc de l'oncle Henry
FA Le truc de l'oncle Henry G Jakob fils de Jakob
G Jakob fils de Jakob H L'espace de la musique
H L'espace de la musique I Lélie ou La vie horizontale
I Lélie ou La vie horizontale J Le ruban de la Louve
J Le ruban de la Louve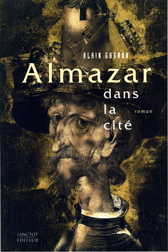 K Almazar dans la Cité
K Almazar dans la Cité L Thomas K.
L Thomas K. M Sud
M Sud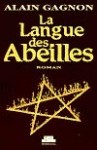 N La langue des Abeilles
N La langue des Abeilles O Gilgamesh
O Gilgamesh